Refaire le personnalisme
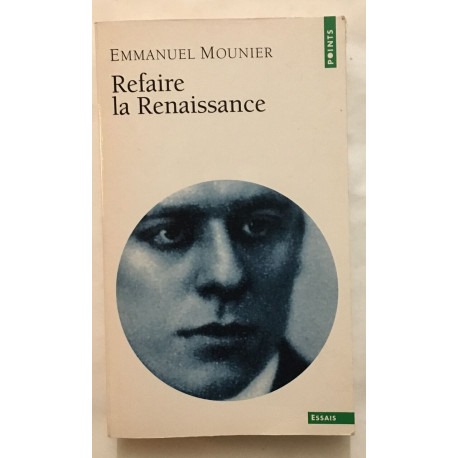
Le personnalisme est familier aux lecteurs et lectrices de cette revue. En décembre 2023 (n°147), Thierry Vuylsteke signait ici un très beau texte sur Emmanuel Mounier, philosophe catholique et figure canonique du mouvement. Il y soulignait notamment le besoin d’articuler toujours avec justesse l’existence intime et le geste public, car l’œuvre de personnalisation suppose « d’une part recueillement, silence et ralentissement, et d’autre part présence au monde, action et engagement ». Bosco d’Otreppe, journaliste à La Libre Belgique, déclarait plus récemment (n°150) qu’En Question demeure « une des rares porte-paroles du personnalisme » en Belgique, rappelant en même temps le caractère « radical » de cette proposition éthique et politique. Nous voulons nous associer à cet enthousiasme afin de poursuivre la réflexion sur un paradigme crucial pour notre temps. Particulièrement, nous souhaitons combattre deux confusions possibles, étrangères bien sûr à la communauté du Centre Avec, mais tenaces dans certaines franges du catholicisme : la tentative d’utiliser le personnalisme pour plébisciter une anthropologie conservatrice, d’abord, la réduction de ses exigences à de vagues notions consensuelles, ensuite. Une fois ces illusions dissipées, nous découvrons une école sans concession, rouge dans sa voix, miséricordieuse en son cœur, qui attend de nous un travail doctrinal à mener sans tarder.
Une théorie politique
L’ambition du personnalisme est politique, au sens où il requiert de l’adhérent un engagement public et interroge les règles qui encadrent nos activités communes, particulièrement le travail et la justice. Ce n’est pas rien de le dire : nombre de catholiques qui voudraient s’en réclamer ont en vue la question bioéthique de la défense de la « vie » au sein de la famille traditionnelle. À leurs yeux, le concept de personne doit fonder une ontologie de l’être humain, pris en considération de sa conception à sa mort naturelle et borné par la réalité biologique du sexe. On le sait : l’Église catholique est malade de la distinction homme-femme, à propos de laquelle elle multiplie les clichés éculés, dont l’affligeant « la femme est accueil fécond, soin, dévouement vital » (pape François). Or ce n’est ni la femme, ni l’homme qui intéresse Mounier : c’est précisément la personne. Et ce n’est ni la vie sexuelle, ni la vie familiale qui en constituent le cadre privilégié : c’est la société personnaliste, qui est une société de personnes. Une communauté politique, donc, que Mounier espérait pour l’Europe.
Contrairement à ce qu’espèrent les « pro-vies », la personne n’est pas d’abord une réalité physiologique ou morale, mais existentielle. « Le respect de la personne humaine, ce n’est que secondairement le respect de la vie »[1], précise Mounier. De cette personne il n’y a pas de définition, ou seulement négative : « La personne est ce qui ne peut être répété deux fois ». Karol Wojtyla, plus connu sous le nom de Jean-Paul II, a fait beaucoup de mal à la pensée chrétienne en se réclamant du personnalisme pour écrire Amour et responsabilité (1962), une somme indigeste dédiée à l’amour conjugal. Ce livre est peut-être la cause, ou au moins la trace, de l’enfermement de l’éthique catholique dans la sphère privée et de son égarement dans des débats stériles sur la contraception ou la masturbation. Comme si l’humain se retrouvait entièrement conditionné par ce qui se joue dans la chambre à coucher, « comme si l’amour que parfois réalisent un homme et une femme n’était pas la réussite de ce que devrait être notre amour pour chaque être » (lettre de Mounier à son épouse, Paulette Leclercq, historienne de l’art bruxelloise).
Il n’y a qu’une détermination chez Mounier : la nécessité d’aimer. Race, sexe, religion, identité culturelle s’effacent derrière cet impératif, qui finalement s’exprime dans le choix que l’on fait d’une cause au-delà de soi. « Une personne n’atteint sa pleine maturité qu’au moment où elle se choisit des fidélités qui valent plus que la vie ». La vie qui compte pour Mounier, c’est la vie donnée, donc qui se dépasse elle-même, aucunement la vie biologique en tant que principe régulateur. On lit ici la possibilité chrétienne de la « conversion », mot si cher à l’auteur, qui implique le renoncement aux déterminations passées au profit d’une obéissance nouvelle. Il est pénible de constater l’obsession catholique pour la famille hétérosexuelle patriote quand Jésus, presque avec ingratitude, répondit à sa mère qui le cherchait : « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? […] Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère » (Marc 3, 33-35). Wojtyla lui-même, dans l’ouvrage susmentionné, accepte que « la parenté spirituelle crée souvent des liens plus forts que la parenté de sang ». De son côté, Mounier a bien vu, malgré les évidents bénéfices d’un cadre familial ou national porteur, à quel point les rhétoriques naturalistes[2] sont solidaires de ce qu’il dénonçait comme « la mystique du proche », qui prétend fixer la mesure de l’individu et le ré-enchâsser dans des communautés regrettées (« village, atelier, famille »). Certes, le personnalisme dénonce le gigantisme des structures anonymes, et il est certain que c’est en créant d’emblée des relations et réseaux alternatifs par rapport aux exigences de compétition qu’on substitue, progressivement, la société personnaliste à la société capitaliste. En ce sens, il y a bien une insistance sur les initiatives locales et Jacques Ellul, écologiste, a raison de souligner dans ses Directives pour un manifeste personnaliste que « vis-à-vis de la société actuelle, notre position est plutôt un refus qu’une action ». Autrement dit : il ne s’agit pas tant de réformer les institutions existantes que d’en forger immédiatement des nouvelles. Néanmoins, le souci des alentours doit toujours, pour Mounier, viser la totalité des sujets spirituels, ayant aussi bien leurs fins en eux-mêmes que dans l’« unité universelle du monde des personnes ».
Politique, le personnalisme l’est d’autant plus que sa racine conceptuelle n’est pas uniquement chrétienne : elle est aussi anarchiste, communiste et socialiste. Peter Maurin, grand admirateur de Mounier et ami de Dorothy Day, principal visage du personnalisme américain, n’hésitait pas à déclarer : « Tout mon système est un communisme utopique et chrétien. Je n’ai pas peur du mot communisme. […] Je ne suis pas opposé à la propriété privée gérée de façon responsable. Mais celles et ceux qui possèdent une propriété privée ne devraient jamais oublier qu’elle leur a été confiée » (The Catholic Worker, juin 1933). Karl Marx est l’un des auteurs les plus cités par Mounier dans sa synthèse intitulée Le Personnalisme (1949) et publiée dans la collection « Que sais-je ? ». Jean-Marie Domenach, qui dirigera la revue Esprit après Mounier, souligne que, dès ses premiers textes, « Mounier est implicitement socialiste ». Ce ne sera d’ailleurs pas qu’implicite : il affirmera sans détour la nécessité de bâtir une économie socialiste, puisqu’il souhaitait « l’abolition des classes formées sur la division du travail ou de la fortune ». Oui, le philosophe avait conscience de la violence sociale imposée par les rapports de propriété et fustigeait l’hypocrisie de celles et ceux qui ne veulent pas voir les enjeux politiques – on doit marteler que le personnalisme est une théorie politique et non pas une morale cléricale – qui forcent à assumer l’exigence de la lutte.
Une éthique du retrait
Si Mounier était rouge, il n’en avait pas moins perçu les limites du marxisme et de ses rejetons. Il y a cette magnifique dialectique : « Il n’est pas de société, d’ordre, ou de droit qui ne naisse d’une lutte de force, n’exprime un rapport de forces, ne vive soutenu par une force. […] Le vrai problème, c’est qu’engagés pour la durée de l’humanité dans une lutte de forces, nous avons en même temps la vocation de lutter contre l’empire de la force et l’installation d’états de force ». La tâche révolutionnaire ne peut se contenter d’une opposition à la domination : elle doit s’arrêter aux frontières de l’intériorité humaine, où soudain l’enjeu redevient éthique. Pour le dire simplement : la société personnaliste a besoin de personnes bonnes, et on ne peut les fabriquer en se contentant d’assainir l’économie. Il faut donc cultiver la patience des relations humaines, et s’exercer aux vertus, dont cinq au moins plaisent à Mounier : sortir de soi, comprendre, prendre sur soi, donner et être fidèle. En outre, on doit laisser le temps à l’humain de « se ramasser » régulièrement, dans le silence et le secret, car l’être ne supporte pas la sollicitation permanente. « L’action, dit Mounier, doit naître de la surabondance du silence» (Refaire la Renaissance). On est loin des fantasmes de reconfiguration sans délai et de transparence totale qui hantent aussi bien la pensée de Lénine que la Silicon Valley[3]. Sous le signe personnaliste, la dureté politique respecte la tendresse quotidienne, qui prend soin d’autrui au-delà des clivages. G.K. Chesterton disait que ce qui distinguait Saint François était sa « courtoisie », mot délicieusement suranné qu’on oublie souvent à gauche, craignant que politesse ne devienne complaisance. Il n’est pourtant pas nécessaire de haïr pour dénoncer. Une autre attitude est possible : « Impitoyables avec les positions, humains avec les hommes » (Mounier, Le destin spirituel du mouvement ouvrier : anarchie et personnalisme).
Tout est en avant
Le premier texte de Mounier dans Esprit s’intitulait « Refaire la Renaissance ». Il s’agit aujourd’hui de « refaire le personnalisme ». Après la mort de son héraut, le mot est tombé en désuétude : réemployons-le. Tout est là pour qu’un travail lucide soit effectué : l’histoire pour en faire une bannière romantique, et les taches pour ne pas le fétichiser[4]. On pourra lire les textes de ses principaux théoriciens, mais on se demandera rapidement où sont les femmes, et s’il existe un féminisme personnaliste. Mounier insistait sur le soin à apporter aux choses familières, Ellul fustigeait le règne de la technique et Day vantait le contact avec la nature : y a-t-il un écopersonnalisme ?
Quoi qu’il en soit, il importe de mettre un terme à cette pseudo-filiation qu’on voudrait lire entre Mounier et les théories du « bien commun » et de la « dignité humaine », des syntagmes tristement galvaudés. Le terme « bien commun » apparaît rarement chez Mounier, et ne semble pas un concept réellement travaillé pour soi. Il faudrait casser cette expression en deux pour retrouver le potentiel subversif de ses deux pôles : le Bien, qui signifie la justice pour toutes et tous, et le commun, qui rappelle cette loi naturelle du goûter enfantin si mal pratiquée par les adultes, une loi parfois appelée partage. Quant à la « dignité humaine », Mounier la mentionne peu telle quelle, et parle plus volontiers de l’« éminente dignité » – mazette, on vibre enfin ! –, par quoi il désigne la situation où chaque individu se tient debout et en responsabilité, et qui manifeste le droit de chacune et chacun à la communion des personnes égales et solidaires. Quand bien même on aurait trouvé quelques notions abstraites pour en faire des valeurs fédératrices, il faudra toujours garder en tête que « pour insérer le personnalisme dans le drame historique de ce temps, il ne suffit pas de dire : personne, communauté, homme total, etc. Il faut dire aussi : fin de la bourgeoisie occidentale, avènement des structures socialistes, fonction initiatrice du prolétariat, et pousser plus précisément encore, année par année, l’analyse des forces et des possibilités» (Qu’est-ce que le personnalisme ?). Le personnalisme est une doctrine d’aujourd’hui et de demain, anti-traditionaliste et sous-exploitée. On gagnerait beaucoup à lui donner un second souffle.
[1] Lorsque la source d’une citation de Mounier n’est pas mentionnée, la citation provient de son texte synthétique : Le personnalisme (1949).
[2] Nous employons ici ce mot pour désigner les discours qui postulent un « ordre naturel » dont on pourrait déduire des règles pour gouverner les humains.
[3] On peut en effet faire un rapprochement entre la pensée politique de Lénine, qui était fasciné par la possibilité de transformer radicalement et rapidement la société et rêvait d’une totalité sociale où chaque chose serait à la bonne place, et le projet de numérisation du monde porté par la Silicon Valley, qui confère, non plus à la décision politique, mais à la technologie le rôle de forger la société optimale.
[4] Pour un hommage critique au projet de Mounier, voir les chapitres qui lui sont consacrés dans Les Murs Blancs (Gallimard, 2021). Lire aussi « Le personnalisme est un anarchisme » dans Il renverse les puissants (Cerf, 2024).

