Numérique et IA : non pas y renoncer mais les transformer !
Faut-il renoncer au numérique et aux « progrès » de l’intelligence artificielle (IA) ? Spécialiste des mutations technologiques, Anne Alombert a co-écrit avec Gaël Giraud Le capital que je ne suis pas ! Mettre l’économie et le numérique au service de l’avenir(Fayard, 2024). Elle pointe les multiples dangers – psychiques, sociaux, politiques, environnementaux – des innovations disruptives des acteurs numériques de la Silicon Valley, mais invite à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain : des dispositifs numériques écologiques et contributifs existent. Il faut les soutenir.
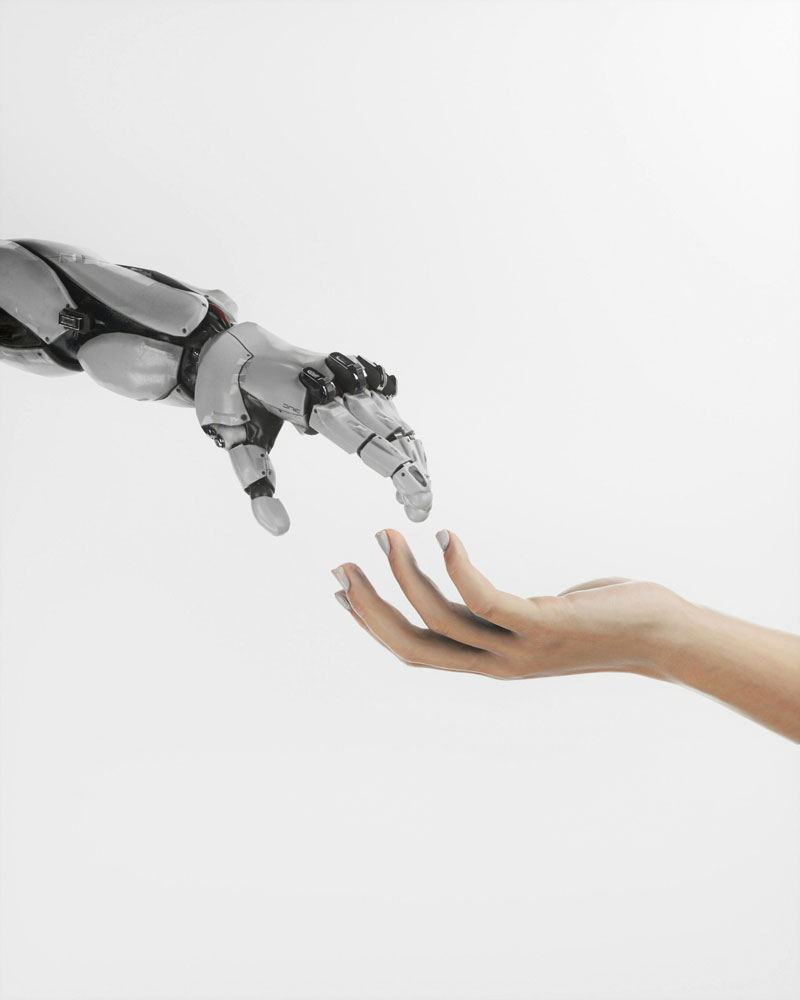
Depuis la réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis le 5 novembre 2024 et la nomination consécutive d’Elon Musk à la direction du Département de l’Efficacité Gouvernementale (à créer), de nombreux médias, parmi lesquels The Guardian, La Vanguardia ou encore Ouest France, ont annoncé leur départ de la plateforme X (ex-Twitter), devenue la propriété de Musk depuis 2022. La campagne électorale américaine s’est en effet caractérisée par la diffusion massive de fausses informations, la circulation virale de contenus truqués et le ciblage publicitaire mensonger – phénomènes auxquels le propriétaire de X s’est allègrement livré, par exemple en postant des centaines de messages quotidiens à ses centaines de millions d’abonnés, en amplifiant l’audience des influenceurs pro-Trump sur sa plateforme ou en achetant des espaces sur d’autres réseaux sociaux pour diffuser des vidéos mensongères au sujet de la candidate adverse.
Dans un tel contexte, les réseaux sociaux numériques qui semblaient servir l’auto-promotion et le débat d’idées sont apparus comme des réseaux antisociaux mettant en péril la possibilité même de la démocratie. Les puissances de l’intelligence artificielle générative, tant louées ces dernières années pour l’efficacité de leurs simulations, se sont révélées comme autant de menaces pour la fiabilité des informations. Le caractère ambivalent des technologies numériques n’a sans doute jamais été aussi patent, les prétendus remèdes semblant progressivement se transformer en autant de poisons – ceci dans la sphère politique comme dans le champ de l’éducation.
Des médias numériques qui pèsent sur la santé mentale des jeunes
En effet, en France, depuis la rentrée scolaire, une « pause numérique » est désormais expérimentée dans les collèges et les lycées, obligeant les élèves à déposer leurs téléphones portables dans des casiers avant d’entrer en classe, pour favoriser leurs capacités d’attention et de concentration. Cette décision fait suite à la publication, en avril 2024, du rapport de la commission d’experts sur l’impact de l’exposition des jeunes aux écrans[1]. Dans la même optique, en Belgique, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé d’interdire l’usage récréatif par les élèves des téléphones portables et autres appareils électroniques connectés dans les établissements scolaires maternels, primaires et secondaires, dès la rentrée 2025-2026. On comprend aisément de telles décisions, quand on sait que les effets des médias numériques, et en particulier des réseaux sociaux commerciaux, sur les capacités psychiques et la santé mentales des jeunes générations sont désormais documentés depuis longtemps.
Dès 2007, les travaux de la chercheuse Katherine Hayles avaient montré que le passage des médias imprimés aux médias numériques conduisait à une transformation des régimes attentionnels, passant d’un régime d’attention profonde (concentration de l’attention sur un objet ou une activité pendant un temps long) à un régime d’hyper-attention (dispersion de l’attention dans plusieurs micro-tâches simultanément)[2]. Dans le domaine des neurosciences, les travaux de Maryanne Wolf vont plus loin, montrant que cette transformation s’opère au niveau même du cerveau : la pratique de la lecture et de l’écriture joue un rôle dans la synaptogenèse[3] en renforçant certaines connexions neuronales. Sa diminution progressive avec l’avènement des médias numériques implique des transformations dans l’organisation cérébrale[4]. Dans le domaine linguistique, les travaux plus récents de Naomi S. Baron montrent que l’utilisation de plus en plus systématique de logiciels de génération automatique de texte fait courir le risque d’une perte des compétences orthographiques et grammaticales, mais aussi de la capacité à réfléchir et à s’exprimer dans un style singulier[5].
Aux risques des supports numériques pour les capacités attentionnelles des jeunes générations s’ajoute la nocivité des réseaux sociaux commerciaux pour la santé mentale des adolescents. En 2021, la publication des Facebook Files révélait les effets nocifs d’Instagram sur l’image de soi des adolescentes, bien connus de l’entreprise Facebook (désormais dénommée Meta, ayant changé de nom en quelques semaines suite à ces révélations)[6]. En 2022, la publication du rapport intitulé « Deadly by design » par le Center for Countering Digital Hate montrait comment l’algorithme de TikTok exploite les fragilités psychologiques de ses jeunes usagers en leur recommandant des contenus promouvant des troubles de l’alimentation ou l’automutilation[7].
Une IA gourmande en eau et en énergie
Outre ces enjeux psychiques et sociaux, les coûts environnementaux des industries numériques posent depuis longtemps question, et le développement fulgurant des intelligences artificielles n’a fait qu’accentuer ce phénomène : les puissances de calcul et les capacités de stockage nécessaires pour faire fonctionner un dispositif comme ChatGPT ou des dispositifs dérivés, impliquent la construction de nouveaux centres de données et une grande consommation d’électricité. De même, la consommation en eau nécessaire pour refroidir les centres de données ne cesse d’augmenter : un échange de vingt questions avec ChatGPT nécessite l’équivalent d’un demi-litre d’eau et, selon un article du journal Reporterre, « d’ici à 2027, l’IA consommera autant que la moitié du Royaume-Uni »[8], alors que la consommation d’eau de Microsoft et de Google a augmenté de 34% et de 20% de 2021 à 2022.
Alors, renoncer au numérique ? Pas si vite
Que ce soit du point de vue de leurs enjeux politiques, sociaux, psychiques ou environnementaux, les technologies numériques, en particulier les réseaux sociaux commerciaux et lesdites « intelligences artificielles génératives », font donc l’objet d’un désenchantement croissant. Et pourtant, le fait de renoncer au numérique pourrait se révéler problématique. En effet, parler du « numérique » en général n’a pas grand sens. La nocivité dont il est ici question concerne en fait un type d’industries bien particulier, à savoir des dispositifs conçus et développés dans les entreprises et les universités de la Silicon Valley, fondés sur la captation industrielle des attentions ou l’exploitation de la culture collective. Toutes deux supposent la collecte de quantités massives de données et leur traitement statistique par des modèles algorithmiques, impliquant des puissances de calcul et des data centers de grande ampleur, qui engendrent une consommation énergétique sans précédent. Qu’il soit aujourd’hui nécessaire de renoncer aux innovations numériques disruptives et permanentes, que le philosophe Bernard Stiegler identifiait déjà il y a dix ans[9], est devenu une évidence : ce modèle industriel met en péril les écosystèmes et les ressources naturelles, la santé mentale et les ressources psychiques ainsi que la vie politique et les ressources culturelles.
Mais cela ne signifie pas qu’il faille renoncer aux technologies numériques pour autant. Au contraire, un tel renoncement pourrait s’apparenter à une capitulation, qui reviendrait à abandonner aux mains de quelques entrepreneurs californiens (ainsi qu’à leurs concurrents chinois) un devenir technologique et industriel qui aurait pu et qui pourrait encore bifurquer vers d’autres directions. Plus les innovations radicales et disruptives s’accéléreront, plus la tendance au repli vers une culture ou une nature pure de toute technique risque de s’affirmer. Le philosophe Gilbert Simondon identifiait déjà ce double mouvement d’accélération du développement technologique et de repli de la culture sur elle-même, à l’œuvre lors de la révolution industrielle : « la Culture dissociée et en état de crise se retranche dans le domaine réduit de la culture, de l’archaïsme, abandonnant les techniques aux forces extérieures et au désordre »[10].
Inventer des dispositifs numériques écologiques…
Pour éviter les fantasmes métaphysiques d’une nature ou d’une culture originaire, ou les déplorations nostalgiques de la belle époque du livre opposée à l’hypnose spectaculaire des écrans, il est nécessaire non pas seulement de résister, mais aussi d’inventer et d’expérimenter des dispositifs numériques alternatifs, soutenables sur les plans de l’écologie environnementale, de l’écologie sociale et de l’écologie mentale. De nombreux dispositifs de ce type existent, qui n’impliquent pas les mêmes coûts environnementaux, car ils ne reposent pas sur l’économie des données et la publicité ciblée, et qui n’impliquent pas les mêmes dangers psycho-sociaux, car ils ne s’appuient pas sur la quantification de l’audience et sur l’automatisation des comportements[11].
À titre d’exemple, on peut bien sûr citer l’encyclopédie collaborative Wikipédia, qui permet la controverse argumentée et la co-construction de savoirs collectifs certifiés. On peut aussi penser aux réseaux sociaux non commerciaux ou décentralisés, comme Bluesky ou Mastodon, qui laissent à leurs utilisateurs la liberté de paramétrer les algorithmes de recommandation, pour éviter les mécanismes d’influence automatisés[12]. On peut également évoquer l’association Tournesol, présidée par Lê Nguyen Hoang, mathématicien et informaticien, qui développe un algorithme de recommandation collaborative, basé sur des jugements et des délibérations humaines, permettant aux citoyens d’évaluer et de recommander des contenus en fonction de leur utilité publique (et non d’amplifier des contenus de propagande automatiques). La plateforme Pol.is, fondée par Colin Megill, Christopher Small et Michael Bjorkegren et expérimentée par le gouvernement taïwanais, permet quant à elle d’organiser des délibérations citoyennes autour de sujets spécifiques grâce à un algorithme mettant en avant les propositions qui font consensus dans des groupes d’opinions différents (à l’inverse des réseaux sociaux commerciaux, qui amplifient les contenus polarisants). Citons encore la plateforme Bip Pop, fruit d’une recherche-action menée par le Laboratoire Costech de l’Université de Technologie de Compiègne et l’Institut Godin, qui permet le renforcement des solidarités locales et de l’engagement citoyen à travers la coordination, par les collectivités, des personnes en situation d’isolement et des bénévoles et des associations disponibles pour les aider.
… avec le soutien du monde politique et de la finance
Toutes ces innovations numériques sont des supports de pratiques contributives au service des populations et des localités, et non des dispositifs de contrôle aux mains de quelques milliardaires libertariens. Elles témoignent du fait que les technologies numériques peuvent contribuer à la préservation et à l’amélioration des milieux écosystémiques, sociaux et symboliques quotidiens. Dans un contexte où le renoncement au numérique apparaîtra bientôt pour beaucoup comme la seule manière de se protéger, de telles innovations contributives devraient bénéficier d’un soutien politique, juridique, économique et financier, et d’une promotion médiatique dont seules jouissent aujourd’hui les innovations disruptives de la Silicon Valley.
Aussi difficile cela semble-t-il, et comme le rappelait déjà Simondon en son temps, nous devons veiller à ne pas faire des objets techniques les bouc-émissaires, en oubliant les programmes politiques, les modèles économiques et les designs psycho-sociaux qui sous-tendent ces industries. Notre époque n’est pas « trop technicienne », affirmait Simondon, elle est « mal technicienne »[13]. Plutôt que de renoncer aux technologies algorithmiques, l’enjeu consiste à repenser l’innovation numérique, pour sortir des modèles destructeurs et disruptifs auxquels nous ont habitués les idéologues de la Silicon Valley, afin de s’orienter vers des modèles contributifs porteurs d’avenir pour les sociétés[14].
Notes :
-
[1] www.elysee.fr/emmanuel-macron/2024/04/30/remise-du-rapport-de-la-commission-dexperts-sur-limpact-de-lexposition-des-jeunes-aux-ecrans
[2] N. Katherine Hayles, « Hyper and deep attention : the generational divide in cognitive modes », Profession, 2007, pp. 187-199.
[3] La synaptogenèse est un processus biologique essentiel au développement et à la fonction du système nerveux. Elle concerne la formation des synapses, ces connexions entre les neurones qui permettent la transmission de l’information nerveuse.
[4] Maryanne Wolf, Proust et le calamari,Abeille et Castor, 2015 et Maryanne Wolf, Reader, Come Home: The Reading Brain in a Digital World, Harper, 2018.
[5] Naomi S. Baron,How we read now, Oxford University Press, 2024.
[6] www.washingtonpost.com/technology/2021/10/25/what-are-the-facebook-papers/
[7] https://counterhate.com/research/deadly-by-design/
[8] www.reporterre.net/Data-centers-leur-consommation-d-eau-va-exploser
[9] Bernard Stiegler, La société automatique. 1. L’avenir du travail, Fayard, 2015 et Bernard Stiegler, Dans la disruption. Comment ne pas devenir fou ?, Les liens qui libèrent, 2016.
[10] Gilbert Simondon, « Psychosociologie de la technicité », dans Sur la technique (1953-1983), PUF, 2014.
[11] Sur ce point, voir Anne Alombert, Schizophrénie numérique, Allia, 2023 et Anne Alombert et Gaël Giraud, Le capital que je ne suis pas ! Mettre l’économie et le numérique au service de l’avenir, Fayard, 2024.
[12] https://theconversation.com/et-si-les-reseaux-sociaux-devenaient-une-chance-pour-nos-democraties-220105
[13] Gilbert Simondon, « Sauver l’objet technique », dans Sur la technique (1953-1983), PUF, 2014.
[14]Anne Alombert et Gaël Giraud, op. cit.

